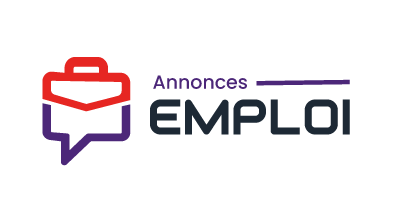Un chiffre, une lettre, un signe plus. « Bac +6 » sonne comme une promesse, une balise posée sur la longue route de l’enseignement supérieur. Pourtant, sur les diplômes officiels français, ce jalon n’existe pas. La reconnaissance institutionnelle s’arrête à bac +8 pour le doctorat, laissant dans l’ombre les chemins de traverse et les titres hybrides. Ce flou, loin d’être anodin, agite les conversations entre étudiants, jeunes diplômés et employeurs qui cherchent à décoder la vraie valeur des parcours post-master.
Les frontières des diplômes intermédiaires, tels que bachelor ou mastère spécialisé, ne font qu’épaissir la complexité d’un système où chaque école, chaque université, revendique ses propres codes.
Panorama des diplômes en France : comprendre les niveaux et appellations
En France, la classification des diplômes repose sur une hiérarchie claire, orchestrée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Chaque niveau, du baccalauréat jusqu’au doctorat, s’inscrit dans un système de repères solidement établi. Le bac ouvre la porte à l’université. Ensuite, la licence (bac +3), le master (bac +5) et enfin le doctorat (bac +8) jalonnent la progression académique, ce dernier demeurant le plus haut diplôme sanctionné par l’État.
Vous ne trouverez aucune trace du terme “bac +6” dans la nomenclature officielle. Les universités et écoles s’alignent sur la structure LMD : licence, master, doctorat. Ce référentiel n’échappe à aucune discipline, qu’il s’agisse de diplômes nationaux ou universitaires. Voici comment se découpent les cycles dans l’enseignement supérieur :
- Premier cycle : licence, diplôme national de licence, formations de niveau bac +3
- Deuxième cycle : master, diplôme national de master, niveau bac +5
- Troisième cycle : doctorat, officiellement reconnu niveau bac +8
La Conférence des grandes écoles introduit d’autres titres, comme le mastère spécialisé ou le MSc. Positionnés après le master, ces diplômes ne relèvent pas tous du cadre universitaire national. Les terminologies fluctuent selon l’établissement, la filière ou le secteur. À l’échelle européenne, la reconnaissance des diplômes s’est harmonisée, mais la structure reste la même : en France, le doctorat domine, sans palier “bac +6” officiellement attribué. Les écoles jouent leur propre partition, mais le référentiel national, lui, ne bouge pas.
Quelle différence entre master, mastère spécialisé, MSc, MBA et doctorat ?
Le paysage français des diplômes post-bac s’est enrichi d’une diversité de titres, chacun répondant à des besoins précis. Après la licence, le master reste la référence nationale. Ce diplôme, accessible après cinq ans d’études, est délivré par les universités et certaines grandes écoles. Il ouvre la voie à la recherche, l’enseignement ou la spécialisation dans des domaines comme les sciences humaines, l’économie, ou le droit.
Le mastère spécialisé (MS), estampillé par la Conférence des grandes écoles (CGE), s’adresse à ceux qui possèdent déjà un master ou équivalent. Ce titre, parfois qualifié de “bac +6”, vise à forger une expertise pointue, directement liée aux attentes des entreprises. Il ne figure cependant pas dans le cadre universitaire national.
À côté, le MSc (Master of Science), proposé en écoles de management ou d’ingénieurs, affiche une forte dimension internationale et s’adresse à des profils variés, avec un niveau exigeant en anglais.
Le MBA (Master of Business Administration) cible les cadres expérimentés voulant élargir leur vision stratégique. Ce diplôme, mondialement reconnu, valorise la transversalité, le développement du leadership et l’ouverture globale.
Le doctorat referme le cycle universitaire. C’est le seul diplôme français officiellement reconnu comme bac +8. Il prouve la capacité à produire de la connaissance inédite, souvent après plusieurs années de recherche. Au-delà de l’université, il ouvre sur des carrières dans la recherche publique, le secteur privé ou l’innovation.
Le doctorat, seul diplôme officiellement reconnu comme bac +8
Le doctorat demeure, en France, la référence ultime du cursus universitaire. Trois diplômes nationaux balisent l’enseignement supérieur : licence (bac +3), master (bac +5) et doctorat (bac +8). Ce dernier valide une formation à la recherche, récompensée par la soutenance d’une thèse originale, généralement après trois années supplémentaires post-master. L’intitulé PhD, reconnu à l’international, correspond à ce diplôme français qui coiffe le parcours académique.
Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ne recense qu’un seul diplôme au niveau 8 : le doctorat. Mastère spécialisé, MSc ou même le DBA (Doctorate of Business Administration) n’accèdent pas à cette reconnaissance réglementaire. Une singularité qui, validée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, confère au doctorat un statut à part auprès des employeurs, qu’ils relèvent du public ou de l’innovation privée.
Ce diplôme, délivré par les universités françaises, prolonge le schéma LMD (licence-master-doctorat). La formation doctorale accueille des profils issus des sciences, des lettres, du droit, de l’économie ou de l’ingénierie. Une fois la thèse soutenue, les docteurs disposent d’une solide expertise méthodologique et de la capacité à mener des projets de recherche d’envergure, des compétences que recherchent aussi bien l’enseignement supérieur que la recherche publique ou des industriels de pointe.
Choisir son parcours après un master ou une thèse : enjeux et perspectives pour sa carrière
Après un master ou un doctorat, la suite ne se résume plus à la recherche ou à l’enseignement. Les diplômés naviguent entre université, secteur public et entreprises. Le choix du parcours oriente la suite, tant en matière d’opportunités que de compétences à valoriser.
La recherche universitaire attire ceux qui veulent produire du savoir. Mais les places sont rares, surtout dans les filières lettres, langues ou droit. Beaucoup se tournent alors vers les entreprises, où la méthodologie acquise pendant la thèse séduit de plus en plus, notamment dans l’innovation ou le conseil.
Des structures telles que Okay Doc Career ou Okay Doc Institute accompagnent les docteurs pour leur insertion professionnelle. Cet accompagnement personnalisé s’étend de Paris à Shanghai, avec un regard ouvert sur l’Europe et l’international. Les recruteurs apprécient les profils hybrides, capables de dialoguer avec des métiers différents et d’apporter une vraie valeur ajoutée à la conduite de projets complexes.
Différentes options s’offrent aux diplômés, selon leurs envies et leur domaine :
- Rejoindre le secteur public : concours réservés aux jeunes docteurs, postes d’ingénieur de recherche, de chargé de mission ou d’attaché temporaire d’enseignement
- Entrer dans une entreprise privée : valorisation des compétences transversales, gestion de l’innovation, management de projet
- Tenter l’aventure internationale : mobilité facilitée par la reconnaissance du doctorat, notamment à Cambridge ou Shanghai, avec une maîtrise de l’anglais validée par le Toefl et une sélection sur dossier ou tests (Gmat, Tage Mage)
Le diplôme obtenu après le bac reste un véritable passeport. Les chemins choisis après un master ou une thèse dessinent des carrières multiples, où se mêlent spécialisation, adaptation et ouverture. Aujourd’hui, le choix n’a jamais été aussi vaste : à chacun de tracer sa route, au-delà des logiques de cases et d’étiquettes.